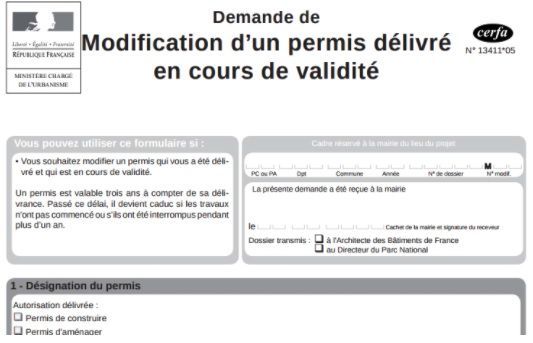Urbanisme : Le Gouvernement durcit les conditions d’accès au juge administratif
Modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme : le Gouvernement durcit les conditions d’accès au juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme
Par Sébastien AVALLONE, Avocat au barreau de Montpellier, Doctorant en droit Public à la Faculté de droit et Science Politique de Montpelier
Et Marion CONSTANTINIDES, Avocat au Barreau de Montpellier
Déjà en 2013, l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 « relative au contentieux de l'urbanisme » trouvait son origine dans le souci du gouvernement de ne pas aborder le débat relatif au projet de loi « ALUR » (« projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ») sans apporter des réponses aux préoccupations que depuis quelques années des parlementaires de tous bords expriment sur le thème des « recours abusifs » contre des autorisations individuelles et des retards, souvent fort substantiels que ces recours entraînent dans la réalisation des projets de construction de logements. »
(V. D. LABETOULLE Une nouvelle réforme du droit du contentieux de l'urbanisme, RDI 2013 p.508)
Le Sénat ayant commencé, ce 16 juillet 2018, l’examen du projet de loi ELAN, le Gouvernement a eu à cœur de limiter une nouvelle fois l’impact du contentieux contre les autorisations d’urbanismes sur la construction de logement. Dans un décret reprenant certains points du rapport Maugüé rendu public le 11 janvier dernier, il complexifie davantage le contentieux des autorisations de l’urbanisme.
Gageons que les objectifs du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) vont dans le même sens que ceux ayant conduit à l’adoption de la réforme de 2013. Il s’agit une nouvelle fois d’une action en vue de « modifier le comportement des acteurs » du contentieux de l’urbanisme (V. D. LABETOULLE,
Contentieux de l'urbanisme : « il faut modifier le comportement des acteurs », AJDA 2013 p.1188).
En outre, les nouvelles dispositions issues du décret du 17 juillet 2018, s’inscrivent pleinement dans la perspective de réduction du délai moyen de jugement prévu dans le projet annuel de performance de la loi de finances pour 2018. En effet, le délai de jugement moyen devant les tribunaux administratifs est fixé comme devant atteindre 10 mois à l’horizon 2020 quand il est actuellement de 10 mois et 15 jours et qu’il doit atteindre 10 mois et 8 jours en 2018. (V. https://www.performance-publique.budget.gouv.fr). C’est donc logiquement que le nouvel article R.600-6 du code de l’urbanisme applicable à partir du 1er octobre 2018 prévoit un délai de jugement de dix mois sur les recours contre les autorisations d’urbanisme. Délai de dix mois qui est supposé régir également les instances d’appel.
Dans la pratique, ces dispositions seront autant de chausse-trapes permettant de rendre plus aisée la défense des pétitionnaires et, complexifiant plus globalement le contentieux administratif.
- Le rôle accru du juge des référés
L’article L.521-1 du code de justice administrative prévoit la faculté pour le juge de suspendre les effets d’une décision administrative « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ledit article maintient une nuance quant à la valeur de cette décision prise « en l’état de l’instruction ».
Le décret du 17 juillet 2018 intègre dans un chapitre du code de justice administrative nouvellement intitulé « la confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure », un article R.615-5-2 selon lequel « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». Ledit article sera applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Ainsi, un rejet pour défaut d’urgence ne saurait entrainer de désistement automatique pour défaut de confirmation du maintien de la requête au fond. Pour autant, il y a lieu de penser que ces dispositions entraineront de fait un nombre certain de désistements tacites. Elles font donc peser un rôle accru sur le juge des référés qui, en ne relevant pas de moyen propre à créer un doute sérieux au terme d’une instruction rapide, est susceptible de faire disparaitre une partie du contentieux.
- Le nouvel article R.600-4 du code de l’urbanisme et l’obligation de justifier de sa qualité pour agir au stade de la requête
A peine d’irrecevabilité, les recours dirigés contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation régie par le code de l’urbanisme doivent désormais être accompagnés d’un document (acte notarié, bail, promesse de vente, …) de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien par le requérant.
Ce nouvel article vient compléter les dispositions de l’article L.600-1-2 en obligeant désormais les requérants à prouver au stade de la requête la régularité de la détention ou de l’occupation de leur bien.
Reste que l'atteinte directe portée par les projets aux conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants devra toujours être démontrée.
De la même manière, et sous peine d’irrecevabilité, les associations devront impérativement produire à l’appui de leur requête leur statut et le récépissé de déclaration à la Préfecture.
Reste à identifier si cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée en cours de procédure. Si tel est le cas, elle n’apporterait pas de grande nouveauté aux possibilités d’argumentation en défense au visa de l’article L.600-1-2. A contrario, si cette irrecevabilité n’est pas régularisable, il y a lieu de penser qu’elle privera nombre de particuliers d’un accès au juge dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, ce dernier n’exigeant pas de ministère d’avocat.
- Un encadrement plus restrictif du débat en recours pour excès de pouvoir contre les autorisations d’urbanisme
Dans l’optique d’accélérer la procédure devant les juridictions administratives, le Décret du 17 juillet 2018 a introduit un article R.600-5 au code de l’urbanisme et va plus loin dans le mécanisme de cristallisation des moyens.
Là où l’article R.600-4 (issu du Décret n°2013-879 du 1er octobre 2013) prévoyait la possibilité de saisir le juge administratif d’une demande motivée afin qu’il fixe une date à partir de laquelle les moyens nouveaux ne pouvaient plus être invoqués, le nouvel article R.600-5 pose le principe selon lequel les moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Entre temps, l’article R.611-7-1 du code de justice administrative (issu du Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016) avait donné plus grande latitude au juge administratif en prévoyant la possibilité, si l’affaire était en état d’être jugée, de fixer une date à partir de laquelle les moyens nouveaux ne pouvaient plus être invoqués.
Désormais, et par dérogation à l’article précité, la cristallisation des moyens devient automatique. L’office du juge se trouvera de fait simplifié en évitant des débats où les requérants distilleraient de manière épisodique leurs moyens.
- La diminution du délai permettant les recours (tardifs) contre les autorisations d’urbanisme
Lorsque l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’a pas été effectué ou, n’a été effectué que de manière incomplète, le délai de recours de deux mois de l’article R.600-2 ne peut commencer à courir. De sorte que le recours pourrait théoriquement être engagé sans condition de délai à l’encontre de ladite autorisation.
Reste que la juridiction administrative tient compte de l’impératif « de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps ».
(En ce sens : CE 13 juillet 2016 n°387763).
Dans la même dynamique, l’article R.600-3 prévoyait qu’aucune action en vue de l'annulation d’une autorisation d’urbanisme n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
Ce délai est désormais réduit à 6 mois au même titre que celui prévu par l’article L.600-1 du code de l’urbanisme pour soulever une exception d’illégalité tirée un vice de forme ou de procédure entachant le Plan Local d’Urbanisme.
- La prolongation du mécanisme de suppression de l’appel en zone tendue
Alors que le rapport du 11 janvier 2018 préconisait que soit tiré un bilan de la suppression de l’instance d’appel pour les litiges portant sur une autorisation de construire un logement en zone tendue, le décret a prorogé ce mécanisme jusqu’au 31 décembre 2022.