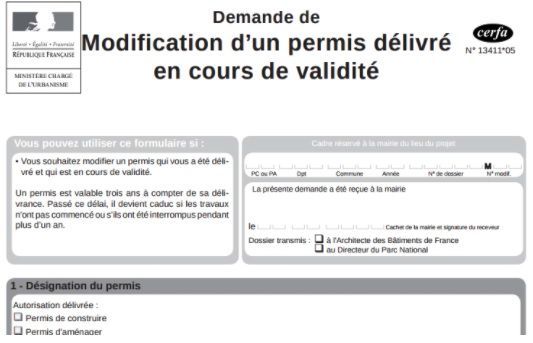Garantie des vices cachés pour une vente immobilière
Il est assez courant que les contrats de vente comprennent une clause d'exclusion de garantie des vices cachés. Malheureusement, après quelques temps, l'acheteur découvrant le vice peut se trouver dans une position inconfortable ne sachant s'il peut obtenir réparation. Les règles de droit applicables en ce cas résultent de dispositions légales issues du code civil et de la jurisprudence qui fait une appréciation au cas par cas des stipulations du contrat de vente.
Dans le code civil
D’une part, l’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
D’autre part, l’article 1643 du code civil dispose :
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
En jurisprudence
- Le défaut doit rendre le bien impropre à sa destination
- Dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination, il n'y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l'acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. (En ce sens : Com. 7 févr. 1995: Defrénois 1995. 1292, note Dagorne-Labbe)Antériorité du vice
Il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe: (En ce sens : Com. 9 févr. 1965: Bull. civ. III, no 103)
- Un vice caché
Il faut que le vice ne soit pas identifiable par l'acheteur au moment de l'achat.
Dans l'hypothèse où le contrat prévoit une exclusion de la garantie des vices cachés,
- Impossibilité d’exclusion de garantie pour le vendeur professionnel
La qualité de professionnel de l'immobilier confère à la SCI venderesse celle de vendeur professionnel. Elle doit en conséquence garantir l'acquéreur des conséquences dommageables du vice, malgré la clause d'exclusion de garantie contenue dans l'acte. (Voir en ce sens : Civ. 3e, 3 janv. 1984: Bull. civ. III, no 4 ; également CA PARIS 27 octobre 1999 AJDI 2000 p.79)
- Encadrement de l’exclusion de garantie pour les vendeurs particuliers
Les juges, qui constateraient que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, ne peuvent, sans dénaturation, refuser d'appliquer une clause de non-garantie stipulant que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés (présence de termites dans l'immeuble vendu ( Civ. 3e, 12 nov. 1975: Bull. civ. III, no 330.)
Lorsque le vendeur avait connaissance du trouble et qu’il l’a caché à l’acquéreur, la clause de garantie des vices cachés est inopérante. (Voir en ce sens : Cass. 3e Civ. 8 avril 2009 n°08-12.960)
Dans une affaire relative à la présence d'infiltrations d'eaux, la Cour de cassation a, par un arrêt de rejet, retenu que « la présence d'humidité dans un immeuble ancien ne pouvant, pour des acheteurs normalement diligents, laisser présager la venue d'eau au sol à l'intérieur de la maison, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un vice caché dès lors que les acquéreurs n'avaient pas eu connaissance du vice dans toute son ampleur ». (Voir. Civ. 3e 15 mars 2011- AJDI 2011 p. 398)
EN SYNTHESE : le vendeur d'un bien immeuble doit, par principe, à son acquéreur garantie des vices cachés. Afin qu'une telle garantie puisse trouver à s'appliquer, il est nécessaire de démontrer que le vice invoqué est rédhibitoire, caché, antérieur à la vente et qu'il trouve sa cause dans le bien transmis. Si une telle garantie a été exclue de manière contractuelle, la mauvaise foi du vendeur ou sa qualité de professionnel peut permettre d’écarter la clause d’exclusion de garantie.
Pour une analyse juridique de votre situation, vous pouvez utiliser le formulaire contact.