Actualités
8 grand rue jean moulin
34000 montpellier
Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Découvrez
nos coordonnées
8 grand rue jean moulin
34000 montpellier
Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Découvrez
nos coordonnée
Blog
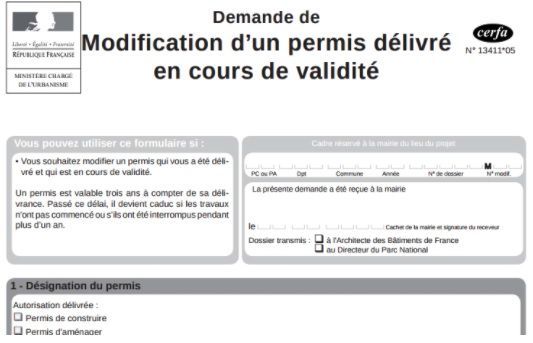
14 févr., 2024
Note d’actualité : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16/06/2023, Commune de Courchevel, n°470160 Synthèse : Par une décision n°470160 du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat précise l’office du juge dans le cadre d’une demande de levée de suspension de l’exécution d’un permis de construire. En outre, cette décision rappelle utilement l’existence d’une troisième possibilité de réaction offerte aux pétitionnaires dont le permis de construire a été suspendu à l’occasion d’un référé, en sus du classique pourvoi en cassation ou de l’attente d’un jugement au fond. *** Par un arrêté du 15 juin 2021, rectifié les 16 et 17 juin 2021, le maire de Courchevel (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SARL Société immobilière de Courchevel pour la démolition et la reconstruction d'un hôtel. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Mésange, de M. et Mme A... ainsi que de M. et Mme B..., a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Courchevel a délivré un permis de construire modificatif à la SARL en vue de régulariser les trois vices retenus par l'ordonnance du 25 mai 2022. À la suite de la délivrance de ce permis modificatif, la Société immobilière de Courchevel a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance du 25 mai 2022. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, contre laquelle la SCI Mésange se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. A l’occasion de cette décision du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat a clarifié l’impact que doit avoir un permis modificatif sur une demande de levée de suspension du permis initial. Pour lui, le juge saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, après avoir mis en cause le requérant ayant obtenu la suspension du permis de construire, doit tenir compte de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation (I), d’une part. Il doit également tenir compte des vices allégués ou d’ordre public dont ce permis modificatif ou cette mesure de régularisation serait entaché et seraient de nature à faire obstacle à la levée de suspension (II), d’autre part. L’analyse de la portée d’un permis modificatif ou d’une mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés : conséquence logique du caractère provisoire d’une ordonnance de référé suspension Pour mémoire, l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». D’un point de vue procédurale, cet article ouvre une troisième possibilité de réaction au pétitionnaire dont le permis de construire a été suspendu dans le cadre d’un référé. Celui-ci n’est pas obligé de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de référé ou d’attendre le jugement au fond. Saisi d’une demande de réexamen, l’office du juge consiste d’abord à analyser la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés. En l’espèce, « le permis de construire modificatif, délivré le 31 octobre 2022 par le maire de Courchevel prend acte de la cession par le département de la Savoie à la SARL Société immobilière de Courchevel des deux parcelles mentionnées au point 10 et d'un nouvel avis de l'architecte des Bâtiments de France précisant les prescriptions relatives à la toiture de la construction et prenant en compte l'ensemble des monuments historiques situés dans les abords du projet ». (V. CE, 10ème et 9ème ch. réunies, 16 juin 2023, n°470160, Point 11). Or, en s’abstenant de tenir compte de la portée du permis modificatif à l’égard des vices précédemment relevés, le juge des référés entache son ordonnance d’une erreur de droit. En revanche, aucune erreur de droit ne pouvait lui être reprochée s’il s’était assuré que le permis de construire modificatif ou la mesure de régularisation corrigeait tous les vices relevés dans la première ordonnance de suspension. Dans le cadre d’un référé réexamen, le fait pour le Conseil d’Etat d’appeler à une analyse de la portée du permis de construire modificatif ou de la mesure de régularisation n’est pas fortuit. Cette lecture des juges du Palais royal reste cohérente dans la mesure où « l’intérêt du permis modificatif [ou de la mesure de régularisation] tient à ce qu’il permet d’apporter des changements au permis initial sans remettre en cause les dispositions non modifiées [ou, s’il s’agit d’une mesure de régularisation, d’éléments non censurés] de celui-ci. Il confère en effet au pétitionnaire la possibilité de faire évoluer son projet sans perdre le bénéfice des droits attachés à l’autorisation qui lui a été initialement délivrée »[1]. La prise en compte des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation seraient entachés et qui seraient de nature à faire obstacle à la levée de suspension Pour le Conseil d’Etat, la levée des effets de suspension d’un référé est aussi conditionnée à la prise en compte des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation seraient entachés et qui seraient de nature à y faire obstacle. Dans cette optique, une double analyse s’impose au juge. Dans un premier temps, son jugement doit se porter uniquement sur les vices propres au permis modificatif. Il ne peut pas concerner les dispositions du permis initial qui n’ont pas été affecté par le permis modificatif[2]. Dans un second temps, le juge doit analyser le permis modificatif au regard du droit positif. Il s’assure que l’autorité administrative ait bien instruit le dossier du projet de modification dans le respect des règles applicables au jour où l’autorisation est délivrée, et non pas au jour où le permis initial a été délivré. En effet, il est de jurisprudence constante que la légalité d’un permis de construire modificatif ou d’un permis de régularisation s’apprécie, sur les points qu’il entend modifier ou régulariser, au regard des seuls dispositions applicables à la date à laquelle il a été pris[3]. MO/SA[1] O. LE BOT, « Ce qui change pour le permis de construire modificatif », in La maîtrise du cadre légal et réglementaire de l’aménagement de son territoire, La Gazette des commune, janv. 2023. [2] V. CE, 28 juillet 1999, n° 182167 [3] V. CAA de Lyon, 19 août 2021, SCI Boulevard des Anglais, n°20LY00270 ; CE, 28 juillet 1989, n°76082

14 févr., 2024
Commentaire de l’Ordonnance du 3 mars 2021 « Il serait en effet singulier que ce juge cesse d’opérer son contrôle sur les actes de l’administration, au moment même où celle-ci commence à porter atteinte aux libertés, alors que le cœur de l’office du juge, de tout juge, est d’assurer l’application de la loi et, d’abord, de protéger les libertés ». (1) Discours de l’ancien Vice-Président du Conseil d’Etat, Monsieur Jean Marc Sauvé, à l’occasion d’un colloque organisé sur le thème « Le juge administratif, protecteur des libertés ». Le décret du 29 octobre 2020, dans sa version issue du décret du 15 janvier 2021 qui a notamment avancé à 18 heures le couvre-feu en vigueur sur l’ensemble du territoire, a prévu des exceptions autorisant ainsi certains déplacements au-delà des heures soumises à couvre-feu. Néanmoins, le décret a abandonné la dérogation retenue dans sa version initiale autorisant les personnes à se rendre chez un professionnel du droit au-delà des heures légales. Cet oubli, regrettable, a conduit l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, par une requête enregistrée le 16 février 2021, à saisir le Juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, motif pris de ce que l’interdiction de toute dérogation porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours juridictionnel effectif. Le requérant faisait valoir notamment qu’une telle interdiction entraînait nécessairement l’impossibilité de disposer de l’assistance effective d’un avocat dans un cadre qui assure la confidentialité des échanges pour trois raisons : La première concernait les personnes ayant des horaires professionnels contraignants ; La deuxième soulignait les inconvénients que représente la généralisation de la téléconférence depuis son domicile ; La troisième dénonçait la rupture d’égalité créée à l’égard des consommateurs face aux professionnels ou aux chefs d’entreprises concernés qui pourraient toujours se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de leur avocat en usant de leur qualité de professionnel. Par une Ordonnance du 3 mars 2021, le Juge des référés du Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’article 4, I du décret du 29 octobre 2020 en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche ne pouvant être réalisés à distance. Cette décision fondamentale pour les professionnels du droit que sont les avocats est l’occasion de revenir sur le rôle du Juge des référés en matière d’état d’urgence (I). Cette décision illustre encore les conséquences de cette situation exceptionnelle sur l’émancipation du juge administratif (II) et son attachement à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif (III). On soulignera l’intervention volontaire du Conseil national des barreaux, de la Conférence des Bâtonniers, la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, le Syndicat des avocats de France et de nombreux barreaux français. LE ROLE RENFORCÉ DU JUGE DES RÉFÉRÉS DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, devenue familière, a inséré un nouveau chapitre dans le code de la santé publique, composé de 9 articles, entérinant ainsi l’état d’urgence sanitaire. (2) Article 2 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 Depuis lors, l’état d’urgence sanitaire « peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 73 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». (3) Article L. 3131-12 code de la santé publique. L’état d’urgence doit être déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (4) Article L. 3131-13 du code de la santé publique. Pressé par l’épidémie de coronavirus qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en janvier 2020 puis de pandémie en mars 2020, le législateur a gravé dans le code de la santé publique ce qui faisait désormais loi dans le pays. Par suite, les décrets, fondés sur les articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, déclarant l’état d’urgence sanitaire, se sont succédés, les lois autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire aussi, le législateur travaillant de concert avec le Gouvernement. En témoignent le décret du 14 octobre 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020 ; la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; la loi du 15 février 2021 modifiant la précédente et prorogeant à son tour, l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus. Bref un calendrier bien rempli ! La déclaration de l’état d’urgence sanitaire a pour incidence d’attribuer à l’administration des pouvoirs exorbitants ; il autorise notamment le Premier ministre à prendre, par décret, des mesures limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion. Les derniers en date, le décret du 29 octobre 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, mesures qui ont été adaptées à l’évolution de la situation sanitaire par les décrets du 27 novembre et du 14 décembre 2020 ainsi que par le décret du 15 janvier 2021. Ce dernier décret, attaqué par la profession, est responsable d’un couvre-feu ramené à 18 heures sur l’ensemble du territoire national et de l’interdiction de se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. La voie du référé-liberté entreprise par l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier paraissait la plus appropriée : Cette procédure permet de remédier au caractère non suspensif du recours devant le juge administratif ; Elle offre un panel de pouvoirs au juge qui peut prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ; Enfin, le juge doit se prononcer dans un délai très court de quarante-huit heures compte tenu de l’urgence. Le choix de cette procédure rapide nous invite à reconsidérer la notion d’urgence. Pour ce faire, le Juge du référé-liberté est « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence ». La mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative suppose donc la démonstration d’un impératif d’urgence. Et cette condition est habituellement examinée plus strictement en ce domaine (V. CE, 28 février 2003, Commune de Pertuis, n°254411). D’ailleurs cette interprétation stricte de la notion d'urgence ressort des premières décisions rendues sous l’état d’urgence sanitaire. Le Juge des référés a, pendant un temps, privilégié de manière quasi-systématique, l’impératif sanitaire. (Voir en ce sens CE, 23 octobre 2020, Cassia : la Haute juridiction a estimé que l’instauration d’un couvre-feu ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales au regard de la forte augmentation de la circulation du virus). Mais en l’espèce, le Juge des référés a, par Ordonnance en date du 3 mars 2021, décidé de la suspension de l’article 4, I du décret du 29 octobre 2020 en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. Seul le dernier considérant traite de l’urgence et de manière anecdotique : la condition n’ayant pas été contestée par l’administration, elle n'est pas débattue. Cette décision institue une présomption d’urgence en matière de référé-liberté introduit contre l’une des mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire. Néanmoins, cette position n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte global d’état d’urgence puisque déjà sous l’état d’urgence décrété à la suite des attentats terroristes de 2015, le Juge des référés avait adopté ce régime de présomption d’urgence dès lors que des mesures liberticides étaient prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 (CE, 11 décembre 2015, Gauthier n°394990 - CE, 11 décembre 2015, Domenjoud n°395009). En 2015, la reconnaissance d’une présomption d'urgence était le seul moyen de garantir l’examen sur le fond des mesures d’assignation à résidence par le juge administratif. Dans l’affaire commentée, le même détour révèle l’émancipation récente du Juge des référés face à l’impératif sanitaire. LA CONCEPTION LIBÉRALE DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ OU L’INSTRUMENTALISATION DU RÉFÉRÉ-LIBERTÉ « La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon ». (5) Expression imagée du principe de proportionnalité que l’on doit au juriste allemand Fleiner. Depuis l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le juge administratif exerce un entier contrôle de proportionnalité sur les mesures de police administrative. Il vérifie leur adéquation à la nature et à la gravité de la menace et recherche si des mesures moins attentatoires aux libertés auraient pu être prises. C’est ainsi que le juge de l’excès de pouvoir opère la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public. Il pondère des intérêts opposés grâce à l’application d’un triptyque classique d’appréciation de la proportionnalité : Ainsi toute mesure restreignant un droit fondamental doit satisfaire à la triple exigence d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens strict. Classiquement, le contrôle de proportionnalité est un contrôle maximum. Le juge administratif approfondi son contrôle normal et opère un « bilan coût-avantage ». Pour rappel, l’article L. 521-2 du Code de justice administrative permet au Juge des référés d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Dès lors, la voie du référé liberté est subordonnée à la démonstration d'une atteinte grave et manifestement illégale. L’illégalité de la mesure doit donc apparaitre évidente. A priori, le contrôle que devrait opérer le juge serait donc un contrôle restreint. Cette décision illustre bien la liberté que s’est octroyé le juge des référés quant à l’étendue de son contrôle. Alors pourtant que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dresse la liste des mesures restrictives de nos libertés pouvant être ordonnées par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la santé. On pourrait presque s’étonner que le Juge des référés ait, en pareille situation, accueillie une telle demande alors même que l’état d’urgence sanitaire accorde des pouvoirs exorbitants au Premier ministre et au ministre chargé de la santé. Mais cette tangente n’est pas nouvelle. En effet, déjà dans le cadre de l’état d’urgence décrété suite aux attentats terroristes perpétrés en 2015, le Juge des référés sanctionnait la légalité des assignations à résidence sur le même fondement faisant fi du caractère manifeste (Voir en ce sens, arrêt Gauthier précité). Finalement dans un contexte particulier où le Gouvernement prédomine, la condition d’une atteinte manifestement illégale semble abandonnée au profit d’une appréciation proportionnée de la restriction contestée. Ce contour du caractère manifestement illégal révèle l’importance accordée au droit à un recours juridictionnel effectif qui doit prévaloir en dépit d’un état d’urgence sanitaire légalement instauré. L’ENRICHISSEMENT DE LA NOTION DU DROIT À UN RECOURS EFFECTIF « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». (5) Article 16 DDHC de 1789 Il est bon de se remémorer les fondements de notre république, proclamés par la Constitution de 1958 et le bloc de constitutionnalité au nom de la sauvegarde des libertés. La séparation des pouvoirs est le siège de notre Etat de droit. Et cette même séparation des pouvoirs a déteint sur notre organisation juridictionnelle actuelle. La Loi des 16 et 24 août 1790 annonçait les prémices de l’indépendance de l’ordre administratif en déclarant que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». La volonté initiale de la Loi sur l’organisation judiciaire était d’empêcher le juge judiciaire d’intervenir dans les affaires de l’administration. Mais l’histoire enseigne qu’elle est à l’origine de notre système dual de protection des libertés. On a pu regretter le choix opéré par l’article 66 de la Constitution de confier la protection des libertés individuelles au seul juge judiciaire. Mais l’office du juge administratif demeurait indispensable pour contrôler les mesures prises pour la sauvegarde de l’ordre public. Et progressivement, le juge administratif s’est érigé, au travers du contrôle des actes et des actions de l’administration, en protecteur des libertés fondamentales pour devenir l’égal de son homologue judiciaire. La première difficulté pour la Haute juridiction administrative était de s’émanciper de sa tutelle politique ; La seconde, de trouver le bon équilibre, sans tomber de la schizophrénie, entre la sauvegarde des libertés publiques et la préservation de l’ordre public qui conduit parfois le juge administratif à limiter les libertés au nom et dans l’intérêt de l’Etat. L’idée ingénieuse du Conseil d’Etat a été de s’inspirer des textes fondamentaux du droit public français qui figurent dans le préambule de la Constitution de 1958 ou dans le bloc de constitutionnalité pour dégager des principes généraux du droit protecteur des libertés contre la toute-puissante administration. On retiendra la décision incontournable Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte dans laquelle le Conseil d’état s’est auto-proclamé compétent pour contrôler l’ensemble des actes administratifs en plaçant le recours pour excès de pouvoir au rang de principe général du droit (CE, Ass., 17 février 1950). Mais le véritable tournant est la reconnaissance de la compétence administrative et donc de son indépendance par le Juge constitutionnel. En se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a dégagé le « principe fondamental reconnu par les lois de la République de la compétence du juge administratif pour l’annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administrative » (CC DC n°86-224 du 23 janvier 1987 Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence). Ainsi « le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique » devenait l’instrument indispensable du juge administratif pour assurer à son tour la pleine protection des libertés fondamentales. Un hommage doit également être rendu à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont la teneur et les retentissements en matière de protection des libertés fondamentales demeurent inégalés. L’article 6 relatif au droit à un procès équitable énumère les droits de la défense. L’article 13 proclame le droit à un recours juridictionnel effectif. L’influence majeure de ce texte n’est plus discutée. Et la décision commentée en est une illustration. L’ordonnance du 3 mars 2021 a été rendue au visa de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le contentieux de l’annulation ou de la réformation a ouvert la voie au juge administratif, la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est son principal outil. Dès le début des années 2000, le Conseil d’Etat a consacré la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge comme liberté fondamentale, d’abord timidement (CE, ord., 3 avril 2002, Min. de l’intérieur c/ Kurtarici n°244686) puis assurément (CE, ord., 18 septembre 2008, Benzineb, n°320384). La possibilité d’assurer de manière effective sa défense est ensuite devenue un droit : le droit au recours effectif (CE, 30 juin 2009, Ministre c/ Beghal, n°328879). Dans cette décision, le Juge des référés s’est imposé comme protecteur de ce droit quelle que soit la nature du litige. De façon désormais constante, le Juge des référés du Conseil d’Etat veille au respect du droit au recours qu’il considère comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Dans la décision commentée, le Juge des référés a sanctionné les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et particulièrement l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche ne pouvant être réalisé à distance au-delà de 18 heures sur le fondement de la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. On peut se féliciter de cette suspension qui non seulement, protège l’exercice de la profession d’avocat dans une période difficile mais également, et surtout, s’inquiète de la réduction des voies de recours concomitante à l’impossibilité matérielle de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat. Ainsi le constat peut être tiré que le juge administratif ne se soucie plus seulement de consacrer l’existence d’un droit au recours mais s’assure de défendre l’effectivité du recours et par conséquent les droits et les libertés de nos concitoyens.

14 févr., 2024
Définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou par son usage »[1], l’artificialisation peut être considérée comme un phénomène qui contribue à la dégradation de la biodiversité. Face à ce phénomène, que les différents textes législatifs depuis la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) n’ont que très peu endigué, la convention citoyenne a émis des propositions fortes. Par suite, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a institué l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN). Celui-ci vise essentiellement l’atteinte de deux objectifs : réduire de moitié le rythme d’artificialisation nouvelle entre 2021et 2031 par rapport à la décennie précédente d’une part, et atteindre une artificialisation nette 0%, c’est-à-dire avoir autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées à l’horizon 2050 d’autre part. Ces objectifs ambitieux intègrent, à une échelle mondiale, les recommandations des Nations Unies qui incitent à accorder une plus grande attention aux petites villes où vit la majorité de la population dans les programmes de planification urbaines[2]. L’objectif ZAN, dont l’enjeu est la protection de l’environnement en maitrisant mieux la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a logiquement été saluée par les différentes sensibilités politiques françaises. Au début de la réforme, l’absence de définition précise a fait croire aux élus locaux qu’ils pouvaient librement donner un contenu aux politiques d’artificialisation. Si la parution de deux décrets d’application le 29 avril 2022 a vite calmé les ardeurs voire « suscité une fronde des élus locaux, qui dénoncent une incohérence par rapport à l’esprit de la loi et redoutent une mort à petit feu des communes rurales »[3] (I), l’adoption par le Sénat le 16 mars 2023 d’une proposition de loi « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de 'zéro artificialisation nette' au cœur des territoires » (II) tend à assouplir le zéro artificialisation nette, les objectifs de l’Etat ou du gouvernement. Les décrets d’application de la loi « climat et résilience » relatifs à l’objectif « zéro artificialisation nette » : une réponse gouvernementale décriée Pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette », le gouvernement fait peser une responsabilité supplémentaire sur les collectivités territoriales. Avec un premier décret n°2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, il a fixé à chaque région un objectif décennal de réduction de l’artificialisation de son territoire. À terme, chaque région devra intégrer ces objectifs dans son document de planification : le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales) ; le plan d'aménagement et développement durable de Corse (article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales) ; le schéma d'aménagement régional (article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales) ; le schéma directeur de la région d'Île-de-France (article L.123-1 du code de l’urbanisme). Dans la même perspective, les documents de planification à l’échelle territoriale (les schémas de cohérence territoriaux), intercommunale ou communale (Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Plan Local d’Urbanisme ainsi que les cartes communales) devraient intégrer les prescriptions régionales afin que les communes et les établissements publics de coopération intercommunales puissent à leur niveau respecter les objectifs fixés. Dans un second décret n°2022-763 du 29 avril 2022, une nomenclature des sols artificialisés et des sols non artificialisés a été fixée, l’artificialisation nette s’évaluant « au regard du solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, sur une période donnée »[4] Un certain nombre d’élus locaux ont dénoncé aussi bien le premier décret fixant les objectifs d’artificialisation que le second relatif à la nomenclature des sols artificialisés et non artificialisés. Les critiques portent d’abord sur le calendrier de modification des documents d’urbanisme fixé par le premier décret cité. « L’échéance de révision des SRADDET et autres documents régionaux avant février 2024 implique une finalisation du travail concret sur le projet de document d’ici le printemps 2023 (au regard des exigences procédurales du code d’urbanisme) ». Or, l’article 194 de la loi climat résilience sanctionne le non-respect du calendrier fixé de manière sévère : « 9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n'est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié. Si le plan local d'urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n'est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ». Ensuite, le fait que la loi ait choisi la Région en tant que collectivité territoriale pour piloter l’atteinte des objectifs du ZAN « peut laisser craindre, dans certains territoires, une association insuffisante des communes et intercommunalités, à qui la loi confie pourtant à titre premier la compétence en matière d'urbanisme »[5]. C’est pourquoi certains plaident pour une meilleure prise en compte des élus communaux qui sont, au demeurant, en première ligne en matière d’urbanisme. Enfin la nomenclature des sols artificialisés et des sols non artificialisés et surtout le mode de calcul du solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées ont suscité la réprobation de la part de certains élus locaux. Cette nomenclature et le mode de calcul qu’il implique sanctuarisent les espaces naturels et obligent une renaturation des espaces artificialisés. Ils posent cependant d’énormes défis aux petites villes qui doivent attirer aussi bien de nouveaux habitants que des investisseurs économiques. Dès lors, ces élus se posent légitimement plusieurs questions : « comment traduire le ZAN dans les politiques publiques ? Comment renforcer l’attractivité de son territoire sans construire sur des terres vierges ? Comment faire pour attirer des jeunes ménages actifs si on ne peut plus leur garantir une maison individuelle avec jardin dans un lotissement ? Comment financer la renaturation d’une friche suite au départ d’un commerce ? »[6] Face à ces interrogations, plusieurs sénateurs de diverses tendances politiques ont déposé, le 14 décembre 2022, une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de la loi climat résilience. L’adoption par le Sénat d’une proposition de loi « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de 'zéro artificialisation nette' au cœur des territoires » : une volonté d’assouplir les objectifs fixés par l’Etat Le texte adopté par le Sénat vise à : « - préciser que la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation est l' incarnation organique de la volonté de territorialiser la mise en œuvre du principe de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, en cohérence avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, de subsidiarité et de différenciation défendus par le Sénat ; - inclure les projets d’intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne parmi les grands projets afin que leur impact en termes d’artificialisation ne soit pas imputé à la collectivité territoriale qui l’accueille ; - prévoir une majoration de la surface minimale de développement communal pour les communes nouvelles ; - ne pas comptabiliser l’artificialisation liée aux bâtiments agricoles ; - clarifier le statut des friches de surfaces artificialisées ; - faciliter le recours au droit de préemption "ZAN" afin que les collectivités territoriales puissent réagir plus vite dans la période transitoire ; - imputer sur la période 2011-2021 les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet avant la loi climat-résilience. » L’adoption définitive de cette proposition de loi peut-elle décrisper les positions entre certains élus locaux et le gouvernement ? La réponse est positive, à en croire les porteurs de la proposition. En tout cas, plusieurs articles adoptés apportent des réponses aux critiques jadis formulées. L’article 5 de la proposition de loi favorise une meilleure concertation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans la mutualisation de projets d’ampleur régionale. Afin de pas trop pénaliser le développement économique des petites villes, le texte prévoit, dans son article 4, d’inclure les projets d’intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne parmi les grands projets, pour que leur impact en termes d’artificialisation ne soit pas imputé à la collectivité territoriale qui les accueille. Adopté le 16 mars 2023 en première lecture par le Sénat, il reste à voir si le texte sera validé en l’état par l’Assemblée nationale. Aucune certitude ne saurait être formulée à cet égard. Au demeurant, malgré de belles avancées, le texte adopté, qui prévoit dans son article 9 que « les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisés », n’est pas exempt de toute critique. SA/MO [1] Article L101-2-1 du Code de l’urbanisme. [2] « Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des villes », [archives], Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales (consulté le 22/03/2023). [3] Cédric Faimali, « Les sénateurs assouplissent le ‘’zéro artificialisation nette’’ », GFA, https://www.lafranceagricole.fr/gestion-et-droit/article/838310/les-senateurs-assouplissent-le-zero-artificialisation-nette, consulté le 22/03/2023. [4] Article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme. [5] Exposé des motifs de la proposition des lois « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de 'zéro artificialisation nette' au cœur des territoires ». [6] « Quel développement territorial à l’ère du Zéro artificialisation nette ? », https://institut-rousseau.fr/quel-developpement-territorial-a-lere-du-zero-artificialisation-nette/, consulté le 23/03/2023.

14 févr., 2024
Il résulte des dispositions de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme que: "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15." Traditionellement, le pétitionnaire fait constater la présence de l'affichage du permis de construire : - Le jour de son affichage - Un mois plus tard - Deux mois plus tard Ces trois constats, réalisés par huissier de justice, permettent d'apporter la preuve d'un affichage continu de nature à rendre opposable le délai de recours contentieux. Par une décision du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat décharge partiellement le pétitionnaire de la charge de la preuve. La Haute juridiction considère qu'en présence d'une preuve d'affichage, il appartient au tiers requérant tardif d'apporter des éléments de nature à mettre en doute la régularité de l'affichage. Voir en ce sens: CE, 1re chs, 19 déc. 2019, n° 421042: « Pour juger que la requête présentée par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 août 2014, n’était pas tardive, le tribunal a estimé que si, par les pièces qu’il produisait, M. A… établissait que le permis attaqué avait été affiché le 17 mai 2014 sur le terrain, il ne produisait en revanche aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage. Toutefois, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Il suit de là qu’en mettant à la charge de M. A… la preuve de la continuité de l’affichage, alors que M. C… se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. » Il s'agit là d'une décision de nature à sécuriser davantage les autorisations d'urbanisme.
par Asma Manai
•
14 févr., 2024
Précision sur la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant » permettant l’urbanisation continue en zone de montagne

14 févr., 2024
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT Un appartement de type P2 et un garage dans un ensemble immobilier dénommé « PARK AVENUE » sis à Montpellier (34000) 48 Rue Andy WARHOL, sur les parcelles cadastrées section SD n°160, n°161, n°165 et n°166, lots n°19 et 60 pour une contenance de 14a, 50 ca. MISE A PRIX 45 000 Euros Outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente VISITE : 22 NOVEMBRE 2019 à 9 heures A la diligence de la SCP LE FLOCH BAILLON BICHAT ADJUDICATION DU 2 DECEMBRE 2019 à 14 heures et suivantes au besoin Au Nouveau Palais de Justice de MONTPELLIER Place Pierre Flotte, Salle “Auguste Comte” DESIGNATION DU BIEN A VENDRE Il s’agit d’un appartement de type P2, représentant le lot n°19 et les 162/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 348/10000ème des parties communes particulières au bâtiment B, escalier B au rez-de-chaussée, pour une surface habitable de 52,50 m², une terrasse pour une surface de 14 m² et un jardin privatif de 12 m². A l’intérieur se trouve un dégagement, une pièce principale avec un coin cuisine, un WC indépendant, une salle de bain et une chambre. Le lot n°60, dans le bâtiment A/B, est un garage au R-1 pour une surface de 12,80 m² représentant les 15/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 222/10000ème des parties communes particulières au bâtiment A/B. Le bien est en bon état et est à ce jour vacant et il n’existe aucun bail. Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, moyennant consignation par chèque de banque ou caution bancaire entre les mains de l’avocat, du 10ème de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 Euros et du montant des frais d’adjudication prévisibles. Affiche légale http://sites.cliqeo.com/875a31db1f6fda39/templates/posts/files/aFFICHE%20LEGALE%20ANDY%20WARHOL.pdf PV descriptif http://sites.cliqeo.com/875a31db1f6fda39/templates/posts/files/pV%20DESCRIPTIF%20MAUCUIT.pdf
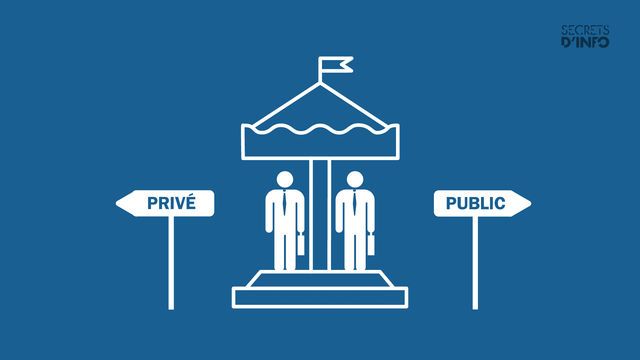
par Asma Manai
•
14 févr., 2024
Le 27 mars dernier, le décret n° 2019-234 a mis en œuvre les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant aux fonctionnaires désireux d’exercer une activité privée pendant une période de disponibilité de conserver leurs droits à avancement durant cinq ans. Ce décret ayant pour objet, d’une part, d’organiser le maintien des droits à l'avancement des fonctionnaires exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité, et, d’autre part, de modifier le régime de la disponibilité pour convenances personnelles, concerne les trois piliers de la fonction publique à la fois: étatique, territoriale et hospitalière. L’article 109 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 est venu modifier l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et concerne les activités professionnelles exercées pendant la disponibilité́. En principe, le fonctionnaire placé en disponibilité́ cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Ce principe connaît désormais une dérogation: lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité́ au cours de laquelle il exerce une activité́ professionnelle, il conserve, dans la limite de cinq ans, ses droits à l’avancement. De telles dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de disponibilitéś prenant effet à compter du 7 septembre 2018.The bod Ainsi, à condition qu’un agent, au cours d’une période de disponibilité, exerce une activité professionnelle, il pourra bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, de ses droits à l’avancement d’échelon et de grade. De fait, cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois. La prise en compte de ces activités professionnelles dans le cadre d’une promotion à un grade à accès fonctionnel sera également envisageable. Pour ce faire, le fonctionnaire en disponibilité est tenu de transmettre à son administration une liste de pièces, fixée par arrêté, attestant de cette activité, au plus tard le 31 mai de chaque année. Quoi qu’il en soit, la durée de la disponibilité ne pourra excéder cinq ans, mais sera toutefois renouvelable une fois si, à l’issue de la première période de cinq ans, le fonctionnaire est réintégré pendant une durée d’« au moins 18 mois » dans la fonction publique. La notion d’activité professionnelle est entendue largement, au sens de l’article 5 du décret, comme « toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel » qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an pour un salarié ou qui procure un revenu au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres de retraite pour un indépendant. Les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement sont fixées par l'article 7 du décret du 27 mars 2019. Certains n’ont pas manqué de soulever divers problèmes qui pourraient se poser notamment dans les collectivités territoriales: Puisqu’un fonctionnaire en disponibilité est désormais contraint de revenir dans sa commune ou son EPCI d’origine pendant 8 mois réglementaires avant de repartir pour une nouvelle période de 5 ans, il est nécessaire qu’un poste soit disponible pour lui à ce moment; dans le cas contraire, la collectivité devra lui verser une allocation chômage avant qu’un poste correspondant à son grade soit vacant, ce qui représentera évidemment une charge financière. D’autres encore se sont étonnés du fait que le dispositif instauré par le décret soit circonscrit à des activités lucratives, et pas étendu à l’exercice d’un mandat électif local, poussant les fonctionnaires à se tourner vers la solution du détachement, la disponibilité́ de plein droit pour exercer un mandat local, la disponibilité́ d’office pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou du parlement européen ainsi que la disponibilité́ d’office quel que soit le motif n’entrant pas dans le champ du maintien des droits à l’avancement.y Enfin, lors de l’examen du texte au Parlement, nombre de sénateurs avaient critiqué le dispositif l’accusant de « faciliter le pantouflage », en établissant une inadmissible « équivalence entre le service de l’intérêt public et celui de l’intérêt privé » Extrait de la Newsletter éditée en partenariat avec l'Association des Anciens Elèves des IRA
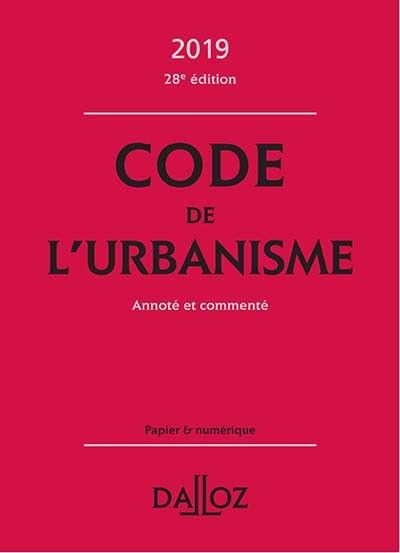
Application de l’article R.111-2 du Code de l'Urbanisme - Note sous l’arrêt CE 26 juin 2019 n°412429
14 févr., 2024
RESUME : Par un arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complété le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en considérant expressément que « le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales » L’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme constitue une partie du Règlement National d’Urbanisme applicable y compris en présence d’un Plan Local d’Urbanisme. Il prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser qu’il appartient au pétitionnaire de proposer des prescriptions spéciales permettant de répondre aux potentielles atteintes à la sécurité ou à la salubrité publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, à première lecture, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être accordée sans prescriptions spéciales en l’hypothèse d’un risque pesant sur la sécurité ou la salubrité publique. Par un arrêt catégorisé en A qui sera publié au LEBON, le Conseil d’Etat clarifie la lecture à opérer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En l’espèce, par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques élevés d'incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 12 mai 2017, contre lequel le pétitionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. C’est en l’état que s’est présentée l’affaire devant les juges du Palais Royal. Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opéré sur le fondement des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif exerce un contrôle normal[2]. Il apprécie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article R 111-2 précitées[3]. A la différence du contrôle restreint opéré lorsque le moyen tiré du non-respect de l’article R.111-2 est soulevé par un requérant[4], le juge administratif bénéficie là d’une véritable marge d’appréciation. Déjà, le Conseil d’Etat estimait que l’autorisation d’urbanisme peut être admise même en présence d’un risque dès lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adéquates[5]. Plus récemment, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a courageusement considéré qu’une commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire à l’identique en se fondant sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme si le risque, bien qu’avéré et ayant entrainé la destruction du bien dont il était demandé reconstruction, pouvait « être paré par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat, par ce qui pourra être qualifié de considérant de principe précise que: « lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. »[7] En reformulant l’article R.111-2 du code de l’urbanisme par la suppression de la négation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autorités chargées d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de démontrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spéciale ne peut y parer. Si le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi, il n’en demeure pas moins que la lecture opérée de l’article R.111-2 semble plus exigeante à l’égard de l’administration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article R.111-2 du code de l’urbanisme [2] En ce sens : CE 10 avril 1974 Min. Aménagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens : CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir également : CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple : CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens : CE Avis 23 février 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 février 2007 Préfet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens : CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de Guéthary n°16BX03937 [7] Voir : CE 26 juin 2019 n°412429
14 févr., 2024
Il est assez courant que les contrats de vente comprennent une clause d'exclusion de garantie des vices cachés. Malheureusement, après quelques temps, l'acheteur découvrant le vice peut se trouver dans une position inconfortable ne sachant s'il peut obtenir réparation. Les règles de droit applicables en ce cas résultent de dispositions légales issues du code civil et de la jurisprudence qui fait une appréciation au cas par cas des stipulations du contrat de vente. Dans le code civil D’une part, l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » D’autre part, l’article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » En jurisprudence Le défaut doit rendre le bien impropre à sa destination Dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination, il n'y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l'acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. (En ce sens : Com. 7 févr. 1995: Defrénois 1995. 1292, note Dagorne-Labbe)Antériorité du vice Il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe: (En ce sens : Com. 9 févr. 1965: Bull. civ. III, no 103) Un vice caché Il faut que le vice ne soit pas identifiable par l'acheteur au moment de l'achat. Dans l'hypothèse où le contrat prévoit une exclusion de la garantie des vices cachés, Impossibilité d’exclusion de garantie pour le vendeur professionnel La qualité de professionnel de l'immobilier confère à la SCI venderesse celle de vendeur professionnel. Elle doit en conséquence garantir l'acquéreur des conséquences dommageables du vice, malgré la clause d'exclusion de garantie contenue dans l'acte. (Voir en ce sens : Civ. 3e, 3 janv. 1984: Bull. civ. III, no 4 ; également CA PARIS 27 octobre 1999 AJDI 2000 p.79) Encadrement de l’exclusion de garantie pour les vendeurs particuliers Les juges, qui constateraient que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, ne peuvent, sans dénaturation, refuser d'appliquer une clause de non-garantie stipulant que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés (présence de termites dans l'immeuble vendu ( Civ. 3e, 12 nov. 1975: Bull. civ. III, no 330.) Lorsque le vendeur avait connaissance du trouble et qu’il l’a caché à l’acquéreur, la clause de garantie des vices cachés est inopérante. (Voir en ce sens : Cass. 3e Civ. 8 avril 2009 n°08-12.960) Dans une affaire relative à la présence d'infiltrations d'eaux, la Cour de cassation a, par un arrêt de rejet, retenu que « la présence d'humidité dans un immeuble ancien ne pouvant, pour des acheteurs normalement diligents, laisser présager la venue d'eau au sol à l'intérieur de la maison, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un vice caché dès lors que les acquéreurs n'avaient pas eu connaissance du vice dans toute son ampleur ». (Voir. Civ. 3e 15 mars 2011- AJDI 2011 p. 398) EN SYNTHESE : le vendeur d'un bien immeuble doit, par principe, à son acquéreur garantie des vices cachés. Afin qu'une telle garantie puisse trouver à s'appliquer, il est nécessaire de démontrer que le vice invoqué est rédhibitoire, caché, antérieur à la vente et qu'il trouve sa cause dans le bien transmis. Si une telle garantie a été exclue de manière contractuelle, la mauvaise foi du vendeur ou sa qualité de professionnel peut permettre d’écarter la clause d’exclusion de garantie. Pour une analyse juridique de votre situation, vous pouvez utiliser le formulaire contact.
8 grand rue jean moulin
34000 montpellier
Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Découvrez
<< nos coordonnées
Coordonnées
8 Grand Rue Jean Moulin
34000 Montpellier
Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Nos domaines


